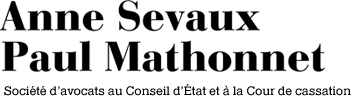Décision historique, – bien que ne réglant pas tout de la question posée – en tant qu’elle consacre le principe de fraternité comme un principe à valeur constitutionnel, et en fait découler « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2018717_718QPC2018717_718qpc.pdf
Ci-dessous notre intervention orale devant le Conseil constitutionnel dans l’intérêt de douze associations intervenantes volontaires (La Cimade, Le Collectif National Droits de l’Homme Romeurope, Emmaüs France, La Fédération des Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s (FASTI), La Fondation Abbé Pierre, Le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), La Cabane Juridique / Legal Shelter, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Le Syndicat des avocats de France, Terre d’Errance).
Conseil constitutionnel
QPC 2018-717/718 – Délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier
Audience du 26 juin 2018
Plaidoirie de Maître Paul Mathonnet, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au nom des douze organisations intervenantes.
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur d’intervenir au nom de douze organisations. Des associations caritatives, humanitaires, d’aide aux étrangers, des organisations syndicales, qui portent la voix de quatre cents autres organisations signataires d’un manifeste intitulé Délinquants solidaires. Leur position est la même que celle exprimée dans de si nombreuses tribunes émanant d’intellectuels, par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) dans plusieurs de ses délibérations, par les réserves émises par le Défenseur des droits, par les interventions des Églises, qui, tous, demandent la suppression effective ce qui est communément dénommé le délit de solidarité.
C’est dire si votre décision est attendue de la société civile.
Et ce d’autant plus que la situation s’apparente aujourd’hui à un dialogue de sourds qu’il convient de désamorcer. Car, selon les autorités de l’Etat, le délit de solidarité aurait été supprimé avec la loi du 31 décembre 2012 au moyen des clauses d’exemption prévues par le 3ede l’article L. 622-4 du Ceseda. En réalité, il n’en est rien.
– D’abord, les exemptions créées par la loi précitée du 31 décembre 2012 ne concernent que l’aide au séjour ; pas l’aide au transport et à l’entrée, même si cette aide a lieu dans un but humanitaire. Que l’Aquariusfranchisse les eaux territoriales, et le délit est constitué.
– Ensuite, s’agissant du seul séjour, ce ne sont pas tous les actes de solidarité, dénués de contrepartie, qui sont exclus de la répression, mais seulement certains. Offrir un vêtement, permettre à un étranger de prendre une douche, encaisser pour son compte un mandat postal : tous ces actes de solidarité qui, d’une part, ne relèvent pas des prestations d’hébergement, de restauration, etc. énumérées par la loi et, d’autre part, ont lieu sans que l’étranger soit en difficulté au point de souffrir dans sa dignité ou son intégrité physique, relèvent encore de la répression.
Vous l’avez compris, et cela vous a déjà été démontré, les termes de l’article L. 622-4 sont bien trop restrictifs.
Mais ce n’est pas tout.
Même lorsqu’ils commettent des actes exemptés et non punissables, les aidants sont inquiétés, à l’image de ce guide de montagne contraint de s’expliquer à la gendarmerie après avoir porté secours à une femme enceinte.
Car, au lieu de définir de manière précise ce qui doit être puni, autour de ce qui constitue la cible de la répression : les filières à but lucratif, le législateur a maintenu une incrimination « râteau » qui permet de présumer que toute aide constitue a prioriun délit, sauf à ce que soit rapportée la preuve que l’on se trouve dans l’un des cas d’exemption. Il en résulte un climat de suspicion généralisée : toute aide est suspecte, puisqu’elle est en principe punissable, sauf preuve contraire. Il est ensuite facile à l’administration d’utiliser des instruments de police judiciaire au prétexte de vérifier qu’une aide, pourtant d’évidence désintéressée, relève bien des causes d’exemption. Audition libre, garde à vue avec inscription dans un fichier de police : tous ces actes ont pour effet de dissuader des citoyens ordinaires de pratiquer la solidarité à leur modeste mais si précieuse échelle.
Et il me revient de dire que cette dissuasion est malheureusement délibérée dans certains territoires de notre République – des territoires où, pour éviter des « points de fixation », « kystes » ou autres phénomènes désignés de manière cynique au moyen de ce vocabulaire médical, l’administration tente d’éviter que la population n’apporte son aide. Oui, il existe des territoires de non-accueil, où rien n’est fait pour assurer un accueil digne, où l’on pratique le refoulement ou la rétention dans des locaux insalubres et où, corrélativement, toute aide apportée par les citoyens est considérée comme un obstacle à l’action de l’Etat.
Ainsi, la solidarité peut encore être un délit ; et lorsqu’elle ne l’est pas, elle est suspecte, voire regardée comme un acte de défiance à l’égard des autorités publiques.
La loi a été déviée de sa cible : les filières à but lucratif.
Elle est désormais instrumentalisée à des fins de police administrative, voir même dénaturée pour un combat d’ordre politique.
C’est cette réalité que les associations intervenantes voulaient d’abord faire entendre.
Mais c’est, ensuite, à long terme que le plus grave se réalisera : lorsque ceux qui pratiquent cette générosité deviendront, à force, de moins en moins nombreux. Ceci à la faveur d’un risque d’ « autocensure » que la CNCDH a relevé avec justesse. Alors, quand disparaîtra l’élan spontané à aider l’autre, quelle que soit sa situation administrative, disparaîtra également le respect de l’autre, et tout ce que notre société a construit depuis plusieurs décennies pour que ce respect soit effectif. C’est là l’inquiétude la plus sérieuse. Et c’est là que prend tout son sens le principe de fraternité invoqué par les requérants.
Nous n’avons aucun doute sur la possibilité que vous avez de juger que si la fraternité ne se décrète pas, et ne s’impose pas, les actes qui la mettent en œuvre – ces gestes désintéressés ou humanitaires – doivent être protégés de toute restriction qui ne serait pas justifiée.
Cette idée n’a rien d’incongru puisque vous avez déjà, par deux fois, exigé du législateur ou du juge qu’il préserve de la répression les organisations à vocation humanitaire. Il s’agit donc, ici, uniquement d’étendre cette protection à toute personne, physique comme morale.
Il ne s’agit pas de consacrer une obligation constitutionnelle de fraternité, mais une protection constitutionnelle de ceux qui décident de mettre en œuvre ce principe.
Par là même, vous serez conduit à ne pas réserver la solidarité aux seuls actes nécessaires à la sauvegarde de la dignité, comme le fait aujourd’hui la loi. L’entraide ne se limite pas au secours ; la fraternité dépasse la sauvegarde de la dignité humaine.
Vous serez conduit, en outre, à vous montrer exigeant quant à la précision des termes employés pour marquer le désintéressement : autrement dit l’absence de contrepartie. Car il convient de ne pas confondre fraternité et altruisme : il n’y a pas de solidarité sans intérêt. L’altruisme c’est le don, et la solidarité le partage. Toute contrepartie n’est pas à exclure, lorsqu’elle procède, soit de la satisfaction d’un intérêt purement moral, soit d’un geste de remerciement, puisque la fraternité est, en principe, réciproque. La contrepartie doit être soit monnayée – ce que propose la CNCDH – soit disproportionnée – ce que proposent les associations.
Ceci étant posé, ce n’est bien évidemment pas d’une immunité totale dont il est question : vous vous limiterez seulement à exiger du législateur qu’il opère une conciliation entre le droit de pratiquer des gestes de fraternité et les autres droits ou objectifs à valeur constitutionnelle qui s’y opposent. En revanche, et ce sera là une nouveauté, vous n’exercerez plus le simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, mais un contrôle de proportionnalité, comme dans toutes les situations où la loi pénale vient heurter un droit protégé. Et, quelle que soit son intensité, ce contrôle de proportionnalité vous conduira ici à la censure.
Ceci pour deux raisons, qui tiennent en deux mots : inadéquation et disproportion.
– En premier lieu, il y a une inadéquation manifeste entre l’incrimination de l’aide au séjour, d’une part, et l’unique objectif poursuivi, qui est la maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l’immigration illégale, d’autre part.
Car, aider au séjour, ce n’est pas aider à l’entrée. Et moins encore faire obstacle à l’exercice, par l’État, de son droit de décider ou non du maintien d’un étranger sur notre territoire. Il n’existe aucun rapport entre, d’un côté, des gestes de solidarité à l’égard d’étrangers déjà en France et, de l’autre, les mouvements migratoires. Le fameux appel d’air n’existe pas. Et y aurait-il appel d’air, nous n’allons pas devenir inhumains pour assurer, par cette inhumanité, la maîtrise de l’immigration…
En réalité, si la loi reste nécessaire, c’est uniquement pour lutter contre l’aide à des fins lucratives. Celle qui fait commerce des frontières et exploite la misère ainsi que le désespoir des candidats à l’immigration. C’était l’objectif que le législateur mettait lui-même en avant en 2012. C’est le modèle préconisé par le droit de l’Union européenne qui n’oblige les Etats à incriminer l’aide au séjour que si cette dernière est réalisée « à des fins lucratives ».
L’objet de la loi dépasse donc largement le but qui lui est assigné, et à ce titre, déjà, la censure est encourue.
– En second lieu, il y a une disproportion manifeste à réprimer tout acte d’entraide, même à but humanitaire, s’agissant autant de l’aide au séjour, que de l’aide à l’entrée et à la circulation.
Que l’on pense un instant aux navires de réfugiés ou aux guides de montagne qui, pour dissuader de jeunes gens d’emprunter des chemins dangereux, leur montrent la voie à suivre. Cette aide au franchissement est à but humanitaire ; elle est en tout état de cause parfaitement désintéressée.
Quoi qu’il en soit, ne nous trompons pas de débat. D’abord, si l’on parle de flux migratoires, ce ne sont pas ces gestes désintéressés qui font que les migrants quittent leur pays ; ce ne sont pas ces gestes qui les font venir en Europe. L’aide désintéressée n’est apportée qu’à l’égard de migrants qui sont déjà là. Et à très modeste échelle. Ce sont les filières à but lucratif qui alimentent les « flux ». Ensuite, si l’on parle de contrôle aux frontières, l’aide ne suppose pas l’emploi de manœuvres ou de procédés tendant à faire échec aux mesures de contrôle. Elle ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’État en ce domaine. L’atteinte à l’objectif de maîtrise des frontières est donc limitée quantitativement et qualitativement.
Par conséquent, l’atteinte portée à cet objectif de maîtrise des frontières est limitée et ne justifie pas que l’on empêche toute aide, y compris celle qui, désintéressée, procède d’un geste de simple fraternité. C’est là que réside la disproportion.
*
En définitive, il vous appartient de faire fixer par le législateur la limite entre l’aide à but lucratif, pénalement réprimée, et l’aide désintéressée.
Pour ce faire, trois possibilités vous sont offertes.
– Vous pourrez en premier lieu prononcer la censure partielle proposée par les requérants. Avec – nous l’ajoutons – une réserve d’interprétation quant à la notion de contrepartie, qui ne doit pas exclure la satisfaction d’un intérêt purement moral, ni être retenue en présence d’un simple geste de remerciement. Mais ceci laissera en l’état l’article L. 622-1, et n’enlèvera rien de l’effet dissuasif que nous avons décrit. Il est à craindre que si vous ne l’y forcez pas, le législateur ne modifie jamais cet article.
– Vous pourriez sinon prononcer la censure globale des articles L. 622-1 et L. 622-4 : c’est la solution la plus logique. Sans doute, cette abrogation pourrait affecter certaines poursuites utiles, car exercées contre des filières lucratives. Cela étant, les autorités de poursuites disposent de nombreuses qualifications alternatives, notamment le délit de traites d’êtres humains, qui peuvent servir de fondement et permettre le maintien de ces poursuites.
– Reste une troisième et dernière solution. Vous procéderez à une abrogation à effet différé, le temps que le législateur décide clairement de ce qu’il faut punir, en précisant, au titre des effets que votre décision remet en cause, que les poursuites en cours ne pourront avoir lieu que selon le dispositif qui vous est proposé à titre de censure partielle, c’est-à-dire uniquement si l’aide au séjour, à l’entrée comme à la circulation a eu lieu avec une contrepartie directe ou indirecte. Cette solution est tout à fait inédite, mais nous paraît tout à fait praticable, et préférable aux deux précédentes.
Pour finir, nous ne doutons pas que la solution que vous allez retenir ne résulte pas d’une simple application du droit positif, et qu’il sera certainement question de volonté ; or nous pensons que l’effort que vous devez entreprendre doit être réalisé, ici et maintenant.
Nous en sommes pour notre part convaincus : c’est le moment, et demain il sera trop tard. Car à l’heure où souffle un vent mauvais en Europe, il est plus jamais nécessaire d’affirmer que la question migratoire ne trouvera jamais sa solution dans la construction de forteresses aux murailles de haine ou d’indifférence, et que la France, elle, assume au contraire que la fraternité est une donnée de la solution, voir la clef du problème.
S’ils avaient sous leurs yeux la situation actuelle, ni le législateur révolutionnaire, ni les rédacteurs du préambule de 1946, ni les auteurs de celui de 1958 n’auraient levé leur plume ; il l’auraient certainement appuyée encore plus fort afin de signifier que, pour reprendre les termes de Jaurès, aller à un idéal, tel celui de la fraternité, n’a de sens que pour le transposer ensuite dans le réel.
Pour ces raisons, vous déclarerez contraires à la Constitution les dispositions contestées.
La Cour de cassation a longtemps jugé que l’interdiction de gérer prévue par les articles L. 653-1 et suivant du code de commerce constituait une« mesure d’intérêt public », qu’elle n’avait à ce titre pas le caractère d’une sanction (Com., 16 octobre 2007, pourvoi n° 06-10805, Bull. civ. IV n° 219) et qu’elle était donc soustraite du champ d’application des principes propres à la matière pénale, notamment le principe de la rétroactivité in mitius (Com., 12 juillet 1994, 93-14179 ; Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-19088, Bull. civ. V n° 193). Cette position était contestée en doctrine et l’a été plus encore lorsque le législateur a modifié, avec la loi du 6 août 2015, les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce en y insérant le terme « sciemment » et en ajoutant ainsi à la répression un élément moral qui était jusqu’alors absent des textes et de la jurisprudence. Il s’agissait précisément, dans la présente affaire, de reprocher à une cour d’appel d’avoir refusé de faire application de ces dispositions plus douces lorsqu’elle jugeait des faits antérieurs à leur entrée en vigueur, et d’avoir ainsi méconnu le principe de la rétroactivité in mitius.
Le demandeur au pourvoi a d’abord posé une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 653-8 du code de commerce modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, tel qu’interprété par la Cour de cassation au terme d’un arrêt en date du 14 juin 2017 (pourvoi n° 15-27851), en tant qu’il n’était pas conforme au principe de la rétroactivité in miutis qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il pouvait en effet être déduit de cet arrêt du 14 juin 2017 qu’en dépit des éléments les plus récents, la Cour de cassation continuait à regarder l’interdiction de gérer comme n’étant pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Il s’agissait ainsi de neutraliser cet arrêt récent, une question prioritaire de constitutionnalité permettant de contester autant le contenu d’une disposition législative que son interprétation lorsque celle-ci résulte d’une jurisprudence établie, et pouvant conduire la Cour de cassation à user de la technique de l’interprétation conforme pour dire n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel et pour donner ainsi, in fine, satisfaction au demandeur lors de l’examen de son pourvoi. En l’occurrence, par un arrêt en date du 24 mai 2018 (pourvoi n° 17-18918), la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à renvoyer la question précitée au Conseil constitutionnel au motif qu’elle n’avait pas pris position, dans cet arrêt du 14 décembre 2017, sur l’application du principe de la rétroactivité in mitius, et qu’elle n’avait donc pas conféré aux dispositions législatives contestées la portée que lui donnait la question posée. L’obstacle qu’aurait pu constituer l’arrêt précité étant ainsi neutralisé, la voie était ouverte pour une évolution de la jurisprudence lors de l’examen du pourvoi. C’est à cette évolution que procède l’arrêt du 24 mai 2018, en affirmant, de manière certes incidente mais ferme, que l’interdiction de gérer constitue une sanction ayant le caractère d’une punition. L’arrêt est ainsi rendu sous le visa suivant : « le respect du principe constitutionnel susvisé, dont découle la règle de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition telle que l’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours ».
L’arrêt prononcé par la première chambre civile illustre le contrôle qu’exerce la Cour de cassation en matière d’indemnisation des préjudices corporels. Pour mémoire, parmi les préjudices extra-patrimoniaux permanents énumérés par la nomenclature établie par la commission présidée par Jean-Pierre Dintilhac, figurent, d’une part les pertes de gains professionnels futurs, qui recouvrent « la perte ou (…) la diminution (des) revenus (de la victime) consécutives à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans le sphère professionnelle à la suite du dommage »et, d’autre part, l’incidence professionnelle qui « a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ».
Rien n’interdit aux juges du fond d’indemniser au titre de l’incidence professionnelle la perte de gains résultant de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident. Une telle solution porterait certes atteinte à la cohérence de la jurisprudence que la Cour de cassation tente d’assurer en se référant de manière systématique à la nomenclature précitée, mais elle ne heurterait à aucune règle ou principe puisque cette nomenclature ne dispose d’aucune valeur légale ou réglementaire. Ce qui est en revanche interdit, c’est de méconnaitre le principe de la réparation intégrale du préjudice en indemnisant deux fois le même préjudice (Civ. 2, 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28774, Bull. civ. II, n° 247 ; 5 février 2015, pourvoi n° 14-10097, Bull. civ. I n° 22). La Cour de cassation a ainsi censuré des arrêts allouant une indemnisation au titre d’une incidence professionnelle liée à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison des séquelles de l’accident en même temps qu’une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs (Civ. 2, 2 mars 2017, pourvoi n° 16-16098 ; voir également Civ. 2, 27 avril 2017, pourvoi n° 16-13360). Inversement, la Cour de cassation a admis le cumul d’une indemnisation allouée au titre d’une perte de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite avec une indemnisation distincte de la perte des droits à la retraite (Civ. 2, 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-1581), ou le cumul d’une indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs liée à la perte de chance pour la victime de retirer des revenus de l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle avec une incidence professionnelle liée à la nécessité de renoncer à l’exercice de la profession de journaliste en raison de son handicap (Civ., 2e, 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-23578). Dit autrement, qu’importe l’étiquette, dès lors que l’indemnisation n’est pas allouée à deux reprises pour le même dommage.
Afin de pouvoir contrôler le respect de ce principe, la Cour de cassation impose aux juges du fond de faire apparaître au sein de leur décision ce qui relève de l’un ou de l’autre de ces postes de préjudice. Dans le cas présent, la cour d’appel avait alloué une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels actuels puis au titre d’une incidence professionnelle liée à l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Estimant que les motifs de l’arrêt ne permettaient pas de s’assurer que ce n’était pas le même préjudice qui était ainsi deux fois indemnisé, faute pour l’arrêt de « caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui qu’elle avait déjà indemnisé au titre des pertes de gains professionnels », la Cour de cassation a censuré la décision pour défaut de base légale au regard de l’article L.1142-1, II, du code de la santé publique – texte applicable en l’état d’un dommage causé par un accident médical non fautif dont l’indemnisation relève de la solidarité nationale et est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, qui était demandeur au pourvoi.
Le volet judiciaire de l’affaire « Pétrole contre nourriture » a été marqué par un mouvement continu de balancier : réquisitoire définitif tendant au non-lieu suivi d’une ordonnance de renvoi ; jugement de relaxe suivi d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2016 condamnant, d’abord, entre autres prévenus, la société Total du chef de corruption active d’agents publics étrangers et, ensuite, certains salariés de cette même société ainsi que le dirigeant d’une société suisse de conseil du chef de complicité d’abus de biens sociaux. Le mouvement se poursuit, en tout cas pour une partie de l’affaire, puisque la Cour de cassation a prononcée une cassation partielle de l’arrêt en question.
Les faits poursuivis sous la qualification de corruption passive d’agents publics étrangers avaient trait à la pratique dite des « surcharges » consistant, pour les acquéreurs de lots de pétrole irakien dans le cadre du programme mis en place par l’ONU et connu sous la dénomination précitée de « Pétrole contre nourriture », à verser en sus du prix fixé dans ce programme des sommes directement sollicitées, hors programme, par les responsables de l’Etat irakien. La difficulté tenait à la qualification du délit de corruption, qui suppose une sollicitation « sans droit » alors que les fonds visés par la prévention avaient ici été sollicités par les autorités irakiennes dans le cadre d’un système établi par les représentants de l’Etat irakien ceci, selon les critiques des différents pourvois, dans le seul intérêt de ce dernier. La Cour de cassation rejette les critiques en retenant qu’il résulte des motifs de l’arrêt « qu’il n’est pas démontré que les commissions occultes, dont le versement était sollicité par les agents de l’Etat irakien, en marge du marché réglementé par la Résolution n° 986 du 14 avril 1995 du Conseil de sécurité de l’ONU, étaient permises ou requises par la loi ou la réglementation écrites de l’Etat irakien »avant de fixer le principe selon lequel « entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article 435-3 du code pénal dans sa version en vigueur à la date des faits, le fait, pour toute personne physique ou morale, de céder aux sollicitations dépourvues de fondement juridique des agents d’un organisme ayant la qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens des mêmes dispositions, relayant une demande de paiement de commissions occultes formulée par les instances représentatives d’un Etat qui en sont les bénéficiaires et à défaut du paiement desquelles toute relation commerciale serait interrompue ». Les pourvois dirigés contre les dispositions de l’arrêt portant condamnation du chef de corruption active d’agent public étranger et de complicité de ce délit ont donc été rejetés.
La cassation a en revanche été prononcée en ce qui concerne les faits poursuivis sous la qualification de complicité d’abus de biens sociaux qui concernaient un autre volet de l’affaire. Etaient en effet en cause des versements réalisés par une filiale de la société Total à un intermédiaire étranger de nationalité libanaise, en rémunération de son intervention pour la conclusion de contrats d’approvisionnement souscrits avec des sociétés qui avaient été agréées dans le cadre du programme « Pétrole contre nourriture ». Ces sociétés s’étaient régulièrement approvisionnées, dans le cadre dudit programme, en pétrole irakien et avaient ensuite cédé ce pétrole à une filiale de la société Total sur le marché secondaire, ce que les règles fixées par l’ONU n’interdisaient aucunement. Ces contrats d’approvisionnement avaient été conclus avant que la pratique précitée des « surcharges » ne soit imposée par les autorités irakiennes, si bien que le délit de corruption d’agent public étranger avait été écarté par le juge d’instruction. Les poursuites visaient en revanche une complicité d’un délit d’abus de biens sociaux, constitué par le fait – commis par des personnes qui n’étaient au demeurant pas identifiées dans les poursuites – d’avoir exposé la société Total à un risque de sanction pénale ou fiscale, ce risque résultant des versements de commissions à cet intermédiaire libanais ceci, selon le juge d’instruction, en violation des règles de l’embargo. Infirmant le jugement de relaxe, la cour d’appel avait considéré que cette exposition de la société Total à un risque pénal ou fiscal résultait de la violation des dispositions du décret n° 90-681 du 2 août 1990réglementant les relations financières avec certains pays. Or, ainsi que le faisaient valoir les pourvois et comme l’a jugé la Cour de cassation, les sanctions prévues par ce texte n’étaient à l’époque des faits applicables qu’en cas de transfert de fonds à des personnes de nationalité irakienne ou résidentes en Irak, ce qui n’était pas le cas de cet intermédiaire libanais, là où l’arrêt de la cour d’appel n’identifiait aucune autre personne ayant bénéficié des fonds. La cour d’appel avait également retenu que le risque pénal et fiscal résultait de l’enregistrement au sein de la comptabilité de la société Total de factures qu’elle qualifiait de fausses, qui avaient été émises par la société suisse précitée. Cette dernière intervenait comme mandataire pour transférer les fonds à l’intermédiaire libanais, et avait émis à ce titre des factures correspondant aux montants versés. Il s’agissait ainsi, pour la cour d’appel, de caractériser le risque pénal et fiscal au regard d’un délit qui aurait été supposément commis à l’occasion de l’utilisation des fonds sociaux, et non du fait de cette utilisation. Il y avait là une extension inédite du champ d’application délit que la Cour de cassation a censurée en relevant que le délit d’abus de biens sociaux n’était pas caractérisé puisque « l‘émission de fausses factures n’était pas l’objectif poursuivi par le délit d’abus de biens sociaux ».
En application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme l’administration chargée d’instruire une demande de permis de construire ne peut délivrer ledit permis qu’après avoir pris position sur tous les aspects du projet et, partant,vérifié sa conformité d’ensemble aux règles qui lui sont opposables (CE, 7 novembre 1973, Sieur Giudicelli, req. n° 85237, Lebon p. 624). Cela suppose, notamment, que l’administration – réputée statuer sur la demande au seul vu du dossier de demande – puisse, à la seule lecture de celui-ci, acquérir une connaissance complète du projet, indépendamment des informations dont elle pourrait disposer à d’autres titres (CE, 18 mars 1970, Sieur Rodde, req. n° 75363, Lebon p. 208). Sur ce fondement, le Conseil d’Etat juge qu’un ensemble de constructions indivisibles doit, par principe, faire l’objet d’un permis de construire unique et, par conséquent, d’une seule et même demande (CE, 10 octobre 2007, M. et Mme Demoures, req. n° 277314). De là, la notion d’ensemble immobilier unique.
Le Conseil d’Etat a ensuite apporté une exception au principe du permis de construire unique en présence d’un ensemble immobilier unique, en jugeant, par un arrêt Commune de Grenobledu 17 juillet 2009, que si une construction « constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique » doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire,il en va différemment« lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés »(CE, Section, 17 juillet 2009, Commune de Grenoble et communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, req. n° 301615, Lebon p. 270).
Ainsi, une construction constituée de plusieurs éléments ne constitue un ensemble immobilier unique que s’il existe, entre ces éléments, des liens physiques et/ou fonctionnels. Et ce n’est que dans une telle hypothèse que la construction doit, par principe, faire l’objet d’un permis unique – sauf exception résultant, d’une part, de l’ampleur et de la complexité du projet et, d’autre part, de la vocation fonctionnelle autonome des éléments de la construction. Toutefois, ainsi que le relevait madame Julie Burguburu rapporteur public, sur cette décision Commune de Grenoble : « la seule circonstance que les travaux projetés s’inscriraient dans un même ensemble architectural ou conceptuel n’implique pas nécessairement à nos yeux le dépôt d’une demande de permis unique – à condition que les constructions ne soient pas physiquement ou légalement nécessaires l’une à l’autre ».
Partant, en présence d’un ensemble architectural, il y a lieu, avant de mettre en œuvre la solution exigeant un permis unique ou de se pencher sur l’exception précitée, de s’interroger sur le point de savoir si les différents éléments composant la construction sont physiquement ou fonctionnellement liés et, précisément, si la réalisation de chacun d’eux est indispensable aux autres. Tel est le cas, par exemple, lorsque deux corps de bâtiments séparés au rez-de-chaussée par un passage ouvert et comportant chacun une toiture indépendante, communiquent à partir du premier étage, et que les logements qui y sont aménagés sont accessibles par un même escalier et desservis par des circulations communes (CE, 25 septembre 1995, Giron, req. n° 120438). De même, constitue un ensemble immobilier formant un tout indissociable une construction répartie sur plusieurs parcelles, dont les sous-sols à usage de stationnement sont communs (CE, 1erdécembre 1995, Ménager, req. n° 137832). A l’inverse, la circonstance qu’une société décide d’édifier un immeuble à usage de bureaux et de services sur une parcelle servant d’assiette à une construction d’immeubles à usage d’habitation n’implique pas, par elle-même, le dépôt d’un permis de construire unique, dès lors que les constructions projetées répondent à des objets distincts et, partant, ne peuvent être regardées comme les éléments d’une même opération (CE, 10 mai 1996, M. et Mme Maleriat Bihler, req. n° 136926). En outre, le Conseil d’Etat a récemment précisé, s’agissant d’un ensemble de constructions distinctes, que : « lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique » (CE, 12 octobre 2016, Société WPD Energie 21 Limousin, req. n° 391092, Lebon Tables). En d’autres termes, lorsque deux constructions sont distinctes, seule la circonstance que l’une ne peut fonctionner sans l’autre au regard des règles d’urbanisme – c’est-à-dire d’un point de vue légal – entraîne la qualification d’ensemble immobilier unique. Toute autre considération est, en revanche, inopérante.
Dans la présente affaire, était en cause un projet architectural porté par deux maîtres d’ouvrage sur deux terrains distincts et ayant donné lieu au dépôt d’une déclaration préalable de travaux – s’agissant de la réhabilitation d’un bâtiment existant sur le premier terrain – et d’une demande de permis de construire et démolir – s’agissant de la construction d’un immeuble locatif sur le second
Le tribunal administratif avait annulé le permis de construire au motif que l’administration n’avait pas été en mesure d’évaluer l’incidence réciproque de ces deux projets par une appréciation globale sur le respect des règles d’urbanisme, après avoir retenu la présence d’un ensemble immobilier unique. Pour ce faire, le tribunal avait relevé que « le programme correspondant aux projets immobiliers de la SAS 3B et de la Foncière 3B, quai Sturm, est d’une ampleur non négligeable », puis relevé que « l’ensemble de ces opérations […] présentent des liens entre elles en raison de l’existence de servitudes de cour commune et de ce que l’impact urbanistique des unes sera au moins partiellement déterminé par les choix architecturaux effectués pour les autres ». En d’autres termes, le tribunal administratif avait considéré qu’il pouvait prendre en compte, pour retenir la qualification d’ensemble immobilier unique, l’existence de liens entre les projets caractérisés uniquement par des servitudes de cour commune et des considérations relatives à l’impact urbanistique et architectural des constructions. Or, ainsi que le faisait valoir la commune devant le Conseil d’Etat, de tels éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour emporter la qualification d’ensemble immobilier unique : celle-ci suppose en effet l’existence de véritables liens physiques et/ou fonctionnels entre les différentes composantes du projet considéré, révélant, entre ces dernières, un rapport d’interdépendance. Et s’agissant – comme en l’espèce – de constructions distinctes, situées sur des unités foncières différentes, ce lien doit, plus encore, revêtir une dimension juridique. Une servitude de cour commune ne peut au demeurant caractériser un tel lien puisque, loin d’imposer une construction sur le fonds servant, elle interdit ou limite le droit de construire. Etablie afin de déroger aux règles de prospect, elle ne peut représenter un lien entre les constructions édifiées sur les fonds concernés. De même, la circonstance que l’impact urbanistique d’une construction soit déterminé par les choix architecturaux effectués pour les autres ne caractérise aucun lien propre à entraîner la qualification d’ensemble immobilier. Outre qu’il ne présente aucune dimension fonctionnelle, un tel lien peut se retrouver dans toutes les configurations de constructions proches ou adjacentes. Le Conseil d’Etat a fait droit à cette argumentation et a jugé que « les deux projets de construction distincts, qui font d’ailleurs intervenir deux maîtres d’ouvrage différents, sont implantés sur deux parcelles désormais séparées et n’ont en commun que l’institution d’une servitude de cour commune, sont indépendants l’un de l’autre »,de sorte que, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal à la faveur d’une erreur de droit, la conformité de chacun des deux projets distincts aux règlesd’urbanisme devait être appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. L’arrêt prononce en conséquence la cassation du jugement.